Le Courage d’être
Chers tous, chères toutes,
Ceux qui ont écouté la prédicat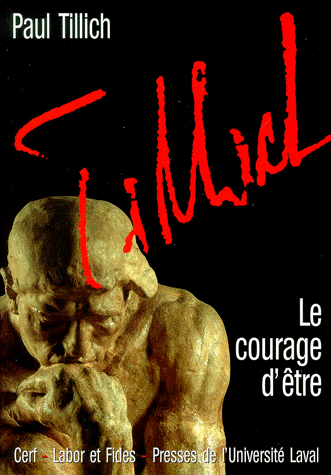 ion d’Yves Bourquin le jeudi de l’Ascension se souviennent peut-être qu’il a mentionné ce « courage d’être » dont parle Paul Tillich. Je me suis donc replongé dans cet autre livre de ce théologien (Le courage d’être, Cerf, Labor et Fides, Presse de l’Université Laval, 1999) afin de vous partager quelques perles de ce livre, pourtant publié déjà en 1952 aux USA.
ion d’Yves Bourquin le jeudi de l’Ascension se souviennent peut-être qu’il a mentionné ce « courage d’être » dont parle Paul Tillich. Je me suis donc replongé dans cet autre livre de ce théologien (Le courage d’être, Cerf, Labor et Fides, Presse de l’Université Laval, 1999) afin de vous partager quelques perles de ce livre, pourtant publié déjà en 1952 aux USA.
Paul Tillich (1886-1965), vécut en Allemagne de sa naissance jusqu’en 1933, c’est-à-dire jusqu’à sa courageuse dénonciation du nazisme ; puis l’autre partie de sa vie se déroula aux Etats Unis, pays d’exil et d’adoption où il fit une brillante carrière de professeur de philosophie et de théologie. Le livre, pour une bonne part, est né d’une série de conférence que Tillich a données à Yale.
« Le courage d’être » est un livre de fond qui apporte une réponse pertinente à la question toujours actuelle de l’angoisse existentielle et du désespoir.
L’auteur distingue d’abord l’angoisse pathologique, accidentelle liée aux circonstances, d’une angoisse existentielle, c’est-à-dire propre à notre être dans le monde. Cette angoisse existentielle n’est pourtant pas ressentie de la même manière ni avec la même intensité à toutes les époques.
Tillich présente
- l’angoisse du destin et de la mort, menaçant le vouloir vivre de l’individu, comme étant caractéristique de la fin de L’Antiquité ;
- l’angoisse de la culpabilité et de la condamnation, menaçant l’affirmation de soi morale, comme étant caractéristique de la fin de Moyen Âge ;
- et de l’angoisse du vide et de l’absurde, menaçant l’affirmation de soi spirituelle, comme étant caractéristique de la fin de la modernité.
Puis l’auteur aborde « le courage d’être », cette bipolarité « soi-monde ». A partir de l’expérience d’être soi dans le monde, Tillich distingue 2 aspects complémentaires du courage d’être :
- le courage d’être soi, c’est-à-dire le courage de s’affirmer soi-même dans son individualité,
- le courage d’être participant ou le courage de s’affirmer en tant que participant à divers secteurs du monde.
L’auteur expose ensuite sa conception de l’être, une conception dynamique de l’être. L’être n’est pas pour lui une identité statique et figée mais une puissance d’être : il est cette puissance d’être qui résiste et conquiert le non-être. Le courage plonge ses racines dans cette dynamique de l’être, dans cette victoire de l’être sur le non-être.
Que faut-il entendre par le non-être ? Le non-être est une puissance de négation au cœur même de l’être ; il dépend de l’être qu’il nie, son existence n’est autre que celle d’une négation parasitaire. Le non-être joue, par rapport à l’être, un rôle analogue à la rouille par rapport au fer.
Le non-être est donc ce qui menace l’être de l’intérieur ET la conscience de cette menace s’appelle l’angoisse.
C’est au sixième et dernier chapitre de son livre que Paul Tillich fait clairement apparaître le caractère religieux, et en dernière analyse, chrétien du courage d’être. Il met en scène un type tout à fait nouveau et décisif de courage : LE COURAGE DE LA FOI. Et Tillich nous propose une version « moderne » de la justification de la foi qui est : ACCEPTER D’ÊTRE ACCEPTÉ EN DÉPIT DU FAIT QUE L’ON SE SENTE INACCEPTABLE.
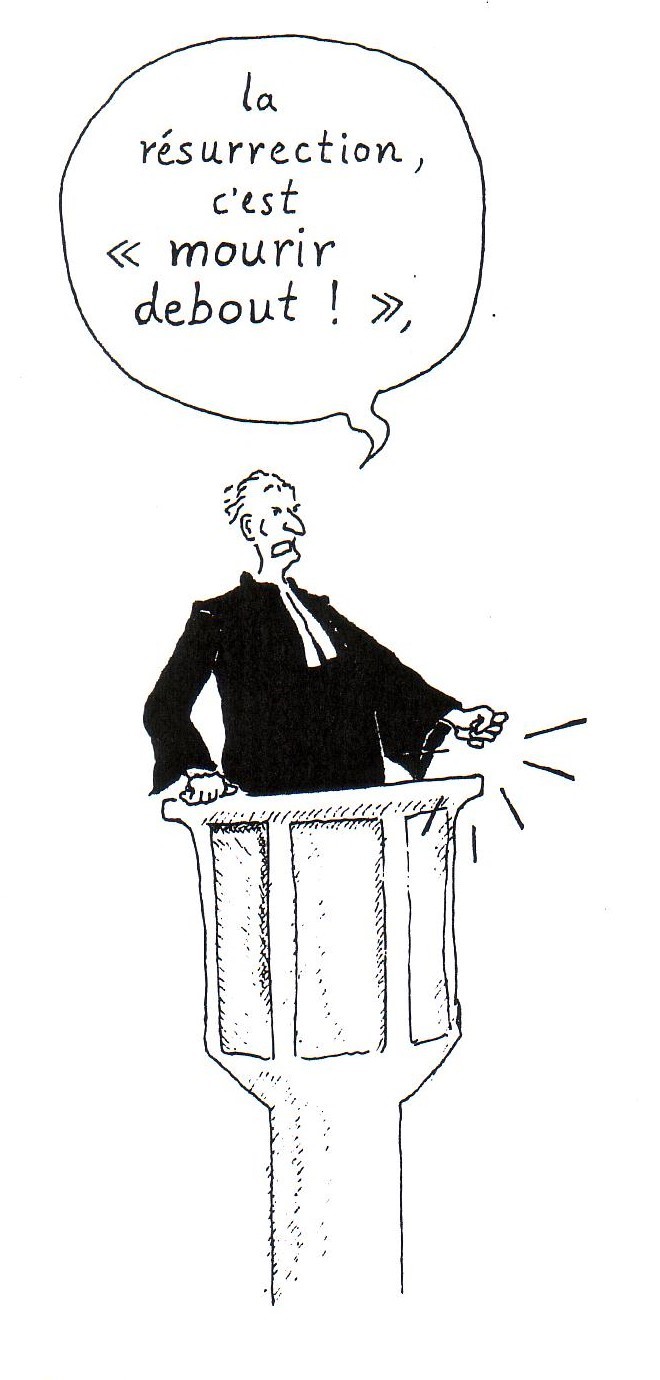 L’enjeu principal du Courage d’être est celui de sauver l’être humain du désespoir en acceptant que l’amour dont Dieu nous aime soit plus grand et plus profond que notre propre refus de nous-mêmes.
L’enjeu principal du Courage d’être est celui de sauver l’être humain du désespoir en acceptant que l’amour dont Dieu nous aime soit plus grand et plus profond que notre propre refus de nous-mêmes.
Pour Tillich, Dieu n’est ni la totalité de l’être ni un être parmi d’autres, mais bien plutôt la source ultime et transcendante de tout ce qui est. Dans l’expérience du courage qui est acceptation paradoxale de soi, Dieu prend figure de l’inconditionné qui fait irruption dans notre histoire pour nous libérer, nous guérir, nous remettre debout et en marche avec tous ceux et celles qui sont portés par l’espérance d’un avenir humainement viable.
A VOUS TOUS, CHÈRES LECTRICES ET CHERS LECTEURS
BON COURAGE!

